Amérique latine – Marchés du travail : embellie conjoncturelle, fragilités persistantes
- 10.12.2024
- 0
- Télécharger la publication (PDF - 315,41 KB)
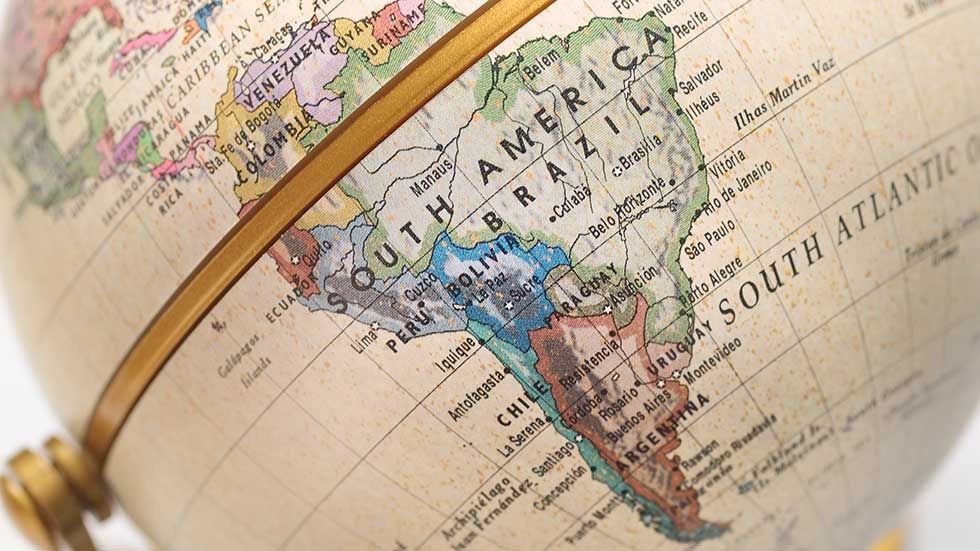
En résumé
Avec des taux de chômage faibles au regard des données récentes mais aussi historiques, les marchés du travail latino-américains se sont révélés dynamiques, affichant une résistance supérieure aux attentes. En Amérique latine (et plus généralement dans les pays émergents), dès qu'est abordée la question du chômage se pose celle du taux d'informalité. Au Pérou, ce taux dépasse 70% et a progressé avec la récession de 2023. Les taux restent élevés au Mexique (54%) et en Colombie (56%). Au Brésil, le taux d'informalité se maintient autour de 40%. Enfin, malgré une légère hausse récente, le Chili affiche le taux le plus faible (28%). L'informalité ne doit cependant pas empêcher de « survoler » ce que livre le marché du travail.
Du côté de l'emploi
Le Brésil se distingue avec un taux de chômage historiquement faible ; il est rejoint par le Mexique (mais les progrès sont moins impressionnants). La Colombie et le Pérou affichent des taux de chômage plus en ligne avec leur moyenne historique. Enfin, le Chili fait exception avec un taux de chômage excédant sa moyenne historique.
Ces taux flatteurs masquent une réalité complexe et des situations nationales hétérogènes. Leur faiblesse s'explique, en partie, par une récupération incomplète de la participation au marché du travail1 , notamment au Brésil (63%), où elle reste inférieure de près de 2 points de pourcentage (p.p.) à son niveau pré-Covid. L'économie brésilienne connaît une croissance robuste, surpassant toutes les prévisions récentes. Cette performance pourrait suggérer une possible augmentation de la croissance potentielle mais indique également que les facteurs de production approchent de leur capacité maximale : le taux de chômage le plus faible jamais enregistré (6,2%) en atteste. Le redressement de l'inflation également. Au Mexique, la participation au marché du travail (60%) a retrouvé son niveau pré-Covid2 , indiquant que la baisse du chômage (à 2,5%, un niveau historiquement bas) résulte de la création d'emplois. Cependant, signe du ralentissement économique, le rythme des créations d'emplois semble fléchir.
La baisse de la participation en Colombie (-0,8 p.p. à 63,9%) et au Pérou (-5,4 p.p. à 72%) a contribué à maintenir le taux de chômage à un niveau relativement stable (respectivement 9,1% et 5,8%), malgré une quasi-récession en Colombie et une récession au Pérou. Enfin, au Chili, la croissance économique faible de 2023 s'est traduite par un taux de chômage élevé (8,5%), supérieur à sa moyenne récente (6,8%) en dépit d'un repli de la participation sous son niveau prépandémie (-1,2 p.p. à 62%). Le revenu fourni par la désépargne (retraits anticipés des fonds de pension) pourrait avoir contribué à cette baisse, en offrant aux salariés la possibilité de ne pas se « précipiter » sur le marché du travail. Compte tenu de la reprise attendue de la croissance, le marché du travail chilien devrait retrouver son dynamisme au cours des prochains mois.
Du côté des salaires
Il s'agit tout d'abord d'observer la dynamique des salaires minimaux en termes nominaux, dynamique qui signale une stratégie volontariste des gouvernements (majoritairement de gauche) et/ou des revalorisations automatiques liées à l'indexation sur les prix. En tête incontestée, le Mexique (140% au total par rapport à décembre 2019), en raison de la politique de revalorisation du salaire minimum menée par le gouvernement d'AMLO au cours des six dernières années et visant notamment à lutter contre la pauvreté3 . Le Chili enregistre une progression de 66% grâce à un rattrapage substantiel mais plus tardif. En Colombie puis au Brésil, les augmentations sont plus modestes (respectivement 57% et 42%). Quant au Pérou, la hausse est limitée à 10%. À l'exception du Pérou, le pouvoir d'achat du salaire minimum a été préservé, malgré une inflation forte.
Les salaires nominaux moyens ont suivi à peu près des rythmes de croissance en ligne avec ceux des salaires minimaux en Colombie (+53%), au Brésil (+37%) et au Pérou (+17%). En revanche, l'effet d'entraînement des fortes revalorisations du salaire minimum a été bien moins marqué au Chili et, surtout, au Mexique où les salaires moyens ont augmenté de, respectivement, 42% et 80%. Ces hausses nominales ont été plus soutenues que l'inflation, notamment au cours de la période récente. Les salaires réels ont donc connu une hausse significative. Le Mexique se démarque avec une augmentation impressionnante de 12%. Suivent Colombie et Chili (6%) puis Brésil (5%). Le Pérou, en revanche, accuse un retard important, malgré la récupération récente. Globalement, hausse des salaires puis désinflation ont permis des gains de pouvoir d'achat qui ont soutenu la consommation privée, important moteur de croissance surtout au Brésil. Si la consommation résiste bien au Mexique, elle est désormais un peu moins dynamique au Pérou et en Colombie. Enfin, au Chili, après une surconsommation « effrénée », la normalisation explique le moindre dynamisme de croissance.
Aller juste un peu plus loin
En Amérique latine, comme dans d'autres économies, la courbe de Phillips, relation empirique négative entre taux de chômage et taux d'inflation, est plus pentue post-Covid. Cette pentification signale un déplacement du « pouvoir » au profit de l'offre de travail qu'expliquent notamment les tensions sur le marché liées au redressement incomplet de la participation. Cela signifie également que le coût de la désinflation n'a pas fortement pesé sur le marché du travail et la production, offrant ainsi plus de latitude aux banques centrales pour mener des politiques monétaires plus agressives. L'augmentation des taux d'intérêt n'a pas eu un impact immédiatement dévastateur sur l'emploi.
Les taux de chômage actuels au Mexique, au Brésil et en Colombie4 sont inférieurs au « NAIRU », le taux de chômage non accélérateur d'inflation. Compte tenu de la résistance de l'inflation liée aux prix des services mais aussi des perspectives de moindre desserrement monétaire aux États-Unis, cela conduit à une plus grande prudence dans l'assouplissement monétaire ; la Banque centrale du Brésil a même procédé à des hausses de son taux directeur. En revanche, au Chili et au Pérou, les taux de chômage excèdent encore le « NAIRU » alors que la croissance ne devrait pas excéder 2,5% en 2025.
L'Amérique latine semble désormais buter sur son taux de croissance potentielle, estimé à un peu plus de 2% : un rythme insuffisant pour rattraper le PIB par habitant des pays développés et dont la hausse est peu probable à court terme. Le taux d'investissement et la productivité globale des facteurs restent faibles. La région est en pleine transition démographique et le vieillissement pourrait limiter la « quantité » de travail. Redresser cette dernière suppose que des mesures structurelles soient prises : elles concernent notamment la lutte contre l'informalité (qui pèse en outre sur la productivité) et l'inclusion des femmes sur le marché du travail. Deux lourdes tâches.
Article publié le 6 décembre 2024 dans notre hebdomadaire Monde – L'actualité de la semaine
1Selon l’Organisation internationale du travail, le taux de participation moyen au marché du travail s’élève à 61% dans l’OCDE.
2La participation féminine au marché du travail a augmenté de 0,9 p.p. par rapport à la période pré-Covid, compensant partiellement la baisse de 1 p.p. de la participation masculine. Mais, alors que le taux de participation masculin (68%) excède celui des femmes de 12 p.p. en moyenne dans l’OCDE, cette différence atteint 32 p.p. au Mexique (13 p.p. au Pérou, environ 20 p.p. au Brésil et au Chili, 25 p.p. en Colombie).
3Cette hausse salariale s'est concentrée sur les États du Nord. Outre le souhait du président AMLO, le salaire minimum a dû être réévalué dans le cadre du nouvel accord de libre-échange (USMCA). Par ailleurs, la proportion de travailleurs au salaire minimum au Mexique a considérablement progressé et représente désormais un tiers de la main-d'œuvre. Cela pourrait suggérer que les salaires déjà identiques au nouveau salaire minimum (i.e. après son augmentation) n’ont pas été ajustés à la hausse. L’effet d’entraînement sur l’ensemble des salaires serait ainsi atténué.
4En Colombie, la pression salariale sur l'inflation est cependant moins forte car une grande partie de la population est payée sous le salaire minimum.

Avec des taux de chômage faibles au regard des données récentes mais aussi historiques, les marchés du travail latino-américains se sont révélés dynamiques, affichant une résistance supérieure aux attentes. Cependant, signe du ralentissement économique, le rythme des créations d'emplois semble fléchir. La région est en pleine transition démographique et le vieillissement pourrait limiter la « quantité » de travail.
Jorge APARICIO LOPEZ, Economiste (stagiaire) - Amérique latine
