Chine – 4e plénum et plan quinquennal, le ballet de la planification reprend à Pékin
- 28.10.2025
- 0
- Télécharger la publication (PDF - 339,11 KB)
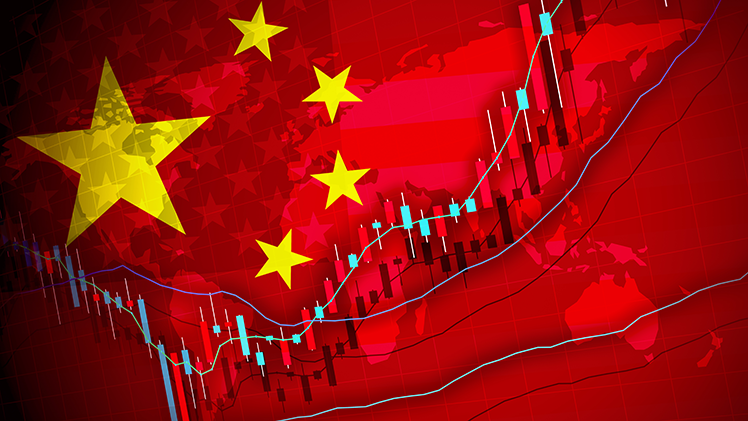
En résumé
Comment rythmer la vie politique d’un pays sans élections, dont le parti unique domine sans partage depuis 1949 ? En Chine, la planification remplace le cycle électoral et obéit à ses propres règles, empreintes d’un formalisme et d’une codification extrêmes. Tout ou presque fonctionne par période de cinq ans. Ce chiffre n’est pas un hasard : il occupe une place centrale dans la symbolique chinoise puisqu’il représente l’équilibre, la stabilité, l’harmonie entre le yin et le yang.
Cinq éléments (métal, bois, eau, terre et feu), cinq directions (nord, sud, est, ouest et centre), cinq couleurs fondamentales (noir, rouge, bleu-vert, blanc et jaune), cinq vertus confucéennes, cinq organes vitaux (cœur, foie, rate, poumons et reins), cinq saveurs, cinq bonheurs (longévité, richesse, santé, vertu et mort naturelle) : le cinq relie les cycles naturels, le corps humain, les grands principes moraux… et rythme donc la vie politique et économique chinoise.
Tous les cinq ans, le Congrès du PCC permet de désigner les membres du Comité Central, du Bureau Politique, du Comité permanent et bien sûr de désigner un Secrétaire général (Xi Jinping, reconduit à ce poste pour la troisième fois en 2022). À l’issue de ce Congrès, l’Assemblée nationale entame elle aussi une nouvelle mandature.
Au cours de ces cinq années, chaque comité se réunit sept fois en plénum thématique. Traditionnellement, le troisième plénum était consacré aux réformes économiques – c’est lors du troisième plénum du 11e Comité central de 1978 que Deng Xiaping avait introduit le grand programme de ʺréforme et ouvertureʺ qui devait mener à l’insertion progressive de la Chine dans l’économie mondiale.
Xi Jinping a cependant renouvelé l’exercice. Le troisième plénum a bien eu lieu, mais avec près d’un an de retard, en juillet 2024. Il n’a pas donné lieu à des annonces de grande envergure, si bien que tous les yeux sont plutôt tournés vers le cinquième plénum, consacré au dévoilement du plan quinquennal. En effet, les plans quinquenaux sont revenus au cœur de l’agenda de Xi Jinping, et permettent généralement de dévoiler les nouvelles orientations de la politique économique chinoise. Le président chinois conçoit la planification comme ʺun avantage politique majeur du socialisme aux caractéristiques chinoisesʺ et l’utilise pour introduire des concepts forts, comme celui de la ʺnouvelle philosophie du développementʺ (2015), ou bien de la ʺcirculation dualeʺ (2020).
Le quatrième plénum, qui se tenait du 20 au 23 octobre à Pékin, était donc annoncé comme une étape-clé pour entrevoir les premières ʺpropositionsʺ qui devraient sans surprise être adoptées et figurer dans le prochain plan, qui couvrira les années 2026 à 2030 et sera dévoilé juste après les ʺdeux sessionsʺ parlementaires, en mars 2026.
Chaque plénum est aussi l’occasion de jauger de l’équilibre des pouvoirs au sein du PCC : le Comité central compte 205 membres et 171 suppléants (sans droit de vote) et chacune de ses réunions fait l’objet d’intenses commentaires sur les présents et surtout les absents. L’exercice du pouvoir chez Xi Jinping se caractérise par un nombre record de d’enquêtes et de purges. Ministres, généraux, membres du Politburo, ces purges touchent le plus haut niveau de l’appareil étatique, et, ces derniers temps, particulièrement l’armée. Cette fois-ci, 16% des délégués (permanents et suppléants), manquaient à l’appel, un record. Les réunions de préparation, permettent au contraire de savoir qui a les faveurs de Xi Jinping et participe aux grandes décisions liées à la planification.
Dans quel contexte économique intervient le Plénum ?
Il serait bien complexe de résumer la situation économique chinoise en quelques lignes, mais le contexte actuel incite à penser que le prochain plan quinquennal s’inscrira plutôt dans une démarche de continuité que de grande rupture.
Plusieurs courants, de nature plus ou moins structurelle, traversent actuellement l’économie chinoise.
- Les tendances de fond : vieillissement et déclin de la population, pari renouvelé d’un modèle de croissance fondé sur la production industrielle, l’investissement et l’exportation, épargne de précaution des ménages pour pallier l’absence de protection sociale ;
- Les éléments plus conjoncturels : univers déflationniste, surcapacités de production, crise immobilière ;
- Les incertitudes, qui concernent plutôt l’environnement externe marqué par un protectionnisme accru aux États-Unis bien sûr, mais aussi dans le reste du monde.
Parmi ces éléments, le plus structurant est peut-être la conviction profonde qu’a Xi Jinping que l’innovation mise au service d’un projet industriel est la clé du modèle de croissance. Depuis la théorisation du ʺMade in China 2025ʺ, puis de la circulation duale, la Chine ambitionne de devenir le leader de la quatrième révolution industrielle (après la vapeur, l’électricité et l’informatique), dominée par les technologies de l’intelligence artificielle, du quantique, de la robotique et de la transition écologique.
Sans surprise, le futur plan quinquennal devrait donc continuer de mettre à l’honneur ces industries, qui sont au cœur du ʺdéveloppement de haute qualitéʺ prôné par Xi Jinping. Ce dernier continue de penser que la croissance passe par l’innovation et l’industrie, et donc par des politiques de soutien à l’offre, plutôt que par le développement de filets de sécurité sociale.
Cette course à l’innovation répond, en outre, à un double objectif, celui de porter la croissance bien sûr, mais aussi à une logique d’autonomie, face à un environnement externe perçu comme de plus en plus hostile. La montée des tensions sino-américaines, qui s’incarne dans la bataille autour des droits de douane mais surtout de l’accès aux nouvelles technologies (des terres rares aux brevets les plus avancés) a conduit Xi Jinping à recentrer sa stratégie et à placer les enjeux de sécurité nationale au cœur des priorités, quitte à faire passer les objectifs de croissance au deuxième plan.
La ʺcirculation dualeʺ est une réponse à l’incertitude externe, et si la Chine se positionne comme un défenseur acharné du multilatéralisme et du libre-échange, son objectif reste avant tout de consolider sa propre autonomie stratégique, un principe qui devrait être rappelé dans le prochain plan quinquennal. Le compte-rendu du quatrième plénum insiste d’ailleurs largement sur la notion d’auto-suffisance et sur la capacité de la Chine à développer les ressources nécessaires pour ʺfaire seuleʺ.
Le nouveau plan répondra-t-il aux paradoxes de l’économie chinoise ?
Le nouveau plan va donc être déployé dans un contexte économique compliqué, qui nécessiterait pourtant des réformes d’ampleur pour s’attaquer aux problèmes structurels chinois et surtout aux paradoxes qui entravent un développement plus harmonieux.
Premier paradoxe, l’affrontement permanent entre croissance quantitative et qualitative. Depuis 2015, Xi Jinping prône sa nouvelle philosophie du développement, qui consiste à passer d’une croissance ʺélevéeʺ à ʺmoyenne-élevéeʺ, plus qualitative, fondée sur l’efficacité et l’innovation.
Dans les faits, il reste très compliqué pour la Chine se sortir de la planification quantifiée à l’extrême. La plupart des économistes s’accordent ainsi pour pointer du doigt la crédibilité des statistiques chinoises, à commencer par celle de la croissance. 5% en 2024, 5% très probablement cette année, alors même que la consommation patine et que la hausse de l’investissement manufacturier n’a pas compensé l’effondrement du secteur immobilier, jusque là premier réceptacle des capitaux privés. Impossible d’imaginer de ne pas affirmer que les cibles de croissance, de brevets, de réduction de la pollution ont été atteintes, que ce soit ou non le cas en réalité.
Y aura-t-il des cibles dans le prochain plan quinquennal et si oui à quel niveau seront-elles fixées ? Cet élément sera clé pour mesurer l’évolution du discours des autorités sur la croissance.
Deuxième paradoxe, lié au premier, celui du rééquilibrage. Les autorités ont reconnu qu’il y avait en Chine un problème de demande, qui se traduit – entre autres – par de l’involution, c’est-à-dire un état permanent de surproduction érodant les prix, les profits, les investissements et donc la croissance potentielle. Pourtant, elles ne semblent nullement prêtes à rééquilibrer la croissance entre offre et demande, entre investissement et consommation. Ce rééquilibrage impliquerait en effet une vraie refonte du système fiscal, avec le développement de nouveaux impôts (notamment liés à la propriété immobilière, socialement très coûteux, alors que la crise immobilière est encore loin d’être résolue) qui permettraient de financer un cadre de protection sociale (chômage, maladie, retraite) plus sécurisant, et donc de diminuer la propension à épargner des ménages chinois.
Or, on voit bien que l’accent continue d’être mis sur l’industrie, à travers le développement des ʺnouvelles forces productivesʺ notamment. Même le programme de subvention (42 milliards de dollars) visant officiellement à redonner du pouvoir d’achat aux ménages en leur accordant des réductions sur un certain nombre de biens (équipements pour le foyer, électronique, voitures) ou de services (tourisme) peut davantage être considéré comme une mesure de soutien aux entreprises chinoises.
Résultat, alors que le programme touche à sa fin, les ventes au détail évoluent à un rythme très inférieur à celui de la croissance. La décorrélation entre leur croissance et celle de la production industrielle est frappante, et traduit ce déséquilibre permanent entre offre et demande. Il est très peu probable pourtant que des réformes de grande ampleur, touchant notamment aux sujets fiscaux et sociaux, soient annoncées en mars prochain. La ʺprospérité communeʺ théorisée par Xi Jinping continuera donc sûrement de reposer sur le pari que la montée en gamme de l’appareil industriel, permise par l’investissement dans la recherche et développement, permettra à terme un ʺruissellementʺ via l’urbanisation et la hausse des salaires.
Troisième paradoxe, celui du rapport à la centralisation, qui provoque de la collusion permanente entre intérêts économiques et politiques. Le futur plan devrait rappeler un autre principe de Xi Jinping, celui du ʺmarché national unifiéʺ, qui vise à combattre les barrières à l’entrée érigées par les gouvernements locaux.
En effet, la Chine se caractérise par une centralisation extrême du pouvoir politique et une décentralisation de la gestion économique, ce qui crée un certain nombre de distorsions. Le Comité Central garde par exemple la main sur toute la gestion humaine (nomination, promotion, rétrogradation) des fonctionnaires, qui sont en revanche évalués suivant les performances économiques de leur périmètre régional.
Croissance, création d’emplois, montant de la production et des recettes fiscales continuent donc de déterminer ou non l’avancement des membres du Parti. Ces derniers n’étant pas soumis au vote populaire par le biais d’élections, la compétition politique se passe sur le terrain économique. Afin d’assurer leur avenir politique, les responsables sont ainsi incités à protéger leur territoire, leurs industries, leurs emplois de manière à atteindre leurs cibles de croissance, à faire preuve d’excès de zèle pour dépasser leurs voisins et concurrents, voire à dissimuler les échecs pour ne pas être sanctionnés.
C’est cette collusion permanente entre politique et économie qui explique des phénomènes comme le shaddow banking et, de manière générale, l’opacité entourant l’endettement des collectivités locales. Les autorités sont sûrement conscientes des difficultés induites par ce mode de gouvernance, mais considèrent que la centralisation politique, et en particulier le pouvoir de punir ou de récompenser, est la clé de voute du modèle chinois.
Depuis deux ans, la peur de voir une crise de surendettement émerger des municipalités a cependant conduit à un effort de transparence autour de l’endettement des collectivités, et une réflexion autour de la répartition des ressources fiscales. En effet, les gouvernements locaux tiraient l’essentiel de leurs ressources propres des opérations immobilières et ont vu leurs recettes fondre avec la crise immobilière. On peut donc s’attendre à ce que le prochain plan quinquennal mette l’accent sur le rôle des collectivités dans la croissance, et définisse plus clairement les moyens qui leur seraient accordés pour y parvenir.

Les plénums rythment la vie politique chinoise. En l’absence de cycles électoraux, la planification permet de donner un cap à l’économie, de la faire progresser, de présenter une vision afin d’embarquer tous les participants, des ménages aux entreprises. Mais la planification n’admet pas de ralentissement ou d’échec, elle suppose une marche forcée vers l’avant, et peu d’introspection sur les erreurs qui auraient pu être commises dans les phases précédentes. Là est toute la complexité de l’économie chinoise : elle s’inscrit dans le temps long, ce qui lui permet de progresser vers un but commun, soutenue par un État interventionniste, mais peine à surmonter les passages à vide conjoncturels, qui marquent tout cycle économique.
Sophie WIEVIORKA, Economiste - Asie (hors Japon)
