L’intelligence artificielle en santé : miracle technologique ou menace éthique ?
- 11.09.2025
- 0
- Télécharger la publication (PDF - 332,23 KB)
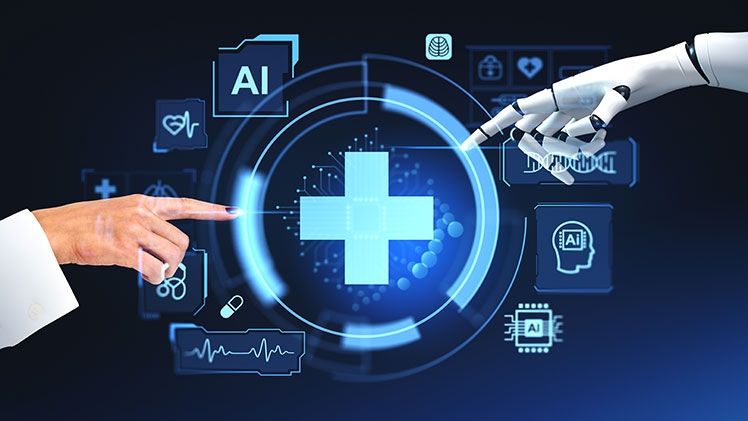
Lire l'article
Le déficit budgétaire de l’Assurance Maladie reflète les tensions d’un système de santé surchargé, caractérisé par un parcours de soins complexe. Dans ce contexte, l’intelligence artificielle (IA) offre des leviers concrets pour transformer le secteur médical : elle optimise la gestion du temps des professionnels de santé, facilite leur pratique quotidienne et promet une amélioration des résultats cliniques pouvant atteindre 40%. Elle permet également de réduire les coûts évitables, notamment ceux liés aux traitements et à l’aide au diagnostic, jusqu’à 50%, selon la faculté de santé publique de Harvard.
Bien que l’IA soit de plus en plus intégrée aux systèmes de santé, elle soulève des interrogations majeures liées à la qualité des données, aux erreurs de diagnostic mais aussi concernant l’éthique et la responsabilité de cette dernière. Grâce à cette dynamique, l’écosystème français compte désormais des start-up plus matures soutenues par des études cliniques fiables.
L’IA concentre les investissements en santé numérique
La santé digitale représente 24,5 milliards d’investissements mondiaux en 2024 dont 4,8 milliards en Europe. La stratégie d’accélération "Santé Numérique"1, lancée dans le cadre du plan France 2030, vise à faire de la France un leader mondial de l’innovation en e-santé en soutenant l’émergence de solutions numériques innovantes. Elle a fait de l’IA sa priorité en concentrant 250 millions d’euros d’investissements dans le secteur. Cette dynamique explique pourquoi plus de 250 start-up, soit plus de la moitié des jeunes entreprises en e-santé, intègrent désormais des technologies d’IA dans leurs solutions. En 2024, les entreprises d’IA appliquée ont levé, rien qu’au premier semestre, 116 millions, soit trois fois plus que l’ensemble des montants de l’année précédente. En 2025, la start-up Nabla2 a levé à elle seule 70 millions de dollars. Les technologies développées dans ce secteur répondent aux enjeux majeurs de la santé : améliorer la prise en charge des patients, optimiser les parcours de soins et renforcer la recherche et l’innovation médicale. Conçues en grande partie pour les établissements de santé, ces innovations s’inscrivent pleinement dans les attentes du marché et les besoins opérationnels du terrain.
L’IA face au diagnostic : entre anticipation et personnalisation
L’intelligence artificielle ne cesse de faire ses preuves dans notre système de santé permettant notamment d’améliorer la prédiction de pathologies, en anticipant les risques, et d’introduire un diagnostic médical rigoureux et adapté à chaque patient. Plus précisément en radiologie, des algorithmes décortiquent les images médicales avec une précision avoisinant les 95%. Ce deuxième œil ne vient pas seulement compléter l’analyse des praticiens, mais anticiper leur diagnostic en détectant des anomalies dès la première phase d’une maladie.
C’est le cas, notamment, de la start-up Therapixel3, spécialisée dans l’imagerie mammaire, elle améliore la sensibilité du dépistage du cancer du sein en permettant une détection précoce dans 50% des cas, apportant un soutien précieux aux radiologues. En oncologie, l’IA croise diverses sources d’informations, des antécédents médicaux aux données génétiques, pour proposer rapidement des traitements précis et ciblés aux patients. Parmi les avancées les plus marquantes, on retrouve CHIEF4, une intelligence artificielle développée par la Harvard Medical School. CHIEF est conçue pour analyser des images histopathologiques5 de tissus tumoraux, elle est capable de lire des lames numériques, d’identifier des caractéristiques cellulaires propres à 19 types de cancers avec un taux de précision de 94%, et de prédire des profils moléculaires sans recourir à un séquençage ADN coûteux. Owkin6, la licorne française, participe aussi à la lutte contre le cancer en proposant aux chercheurs une plateforme d’analyse de données médicales. Ce système intègre une IA reposant sur des données patients anonymisées permettant une meilleure prédiction des probabilités de réussite des traitements.
Et si l’IA impressionne par ses capacités d’analyse et de prédiction, elle se révèle aussi précieuse dans l’optimisation du temps médical et dans l’amélioration des parcours de soins.
Libérer du temps médical : le potentiel administratif de l’IA
Bien que l’IA joue désormais un rôle de soutien auprès des praticiens, son rôle d’assistant administratif reste à ce jour le plus utilisé. En effet, son aide à la prescription et à l’automatisation des tâches est un soutien non négligeable en particulier dans le milieu hospitalier. L’importance croissante de l’IA a été soulignée par l’Assurance Maladie rendant son usage obligatoire dans les outils d’aide à la prescription et à la décision médicale. Elle soutient également la généralisation de l’ordonnance numérique, afin de renforcer la sécurité, la traçabilité et l’efficacité du parcours de soins.
Dans ce contexte, Synapse Medicine7 apparaît comme un candidat naturel pour accompagner cette transformation du secteur. Cette compagnie est à l’origine d’une IA générative qui prévient les erreurs de prescriptions, génère automatiquement des ordonnances et peut proposer des alternatives thérapeutiques. De même Nabla et Hopia8 se distinguent dans l’assistance médicale en libérant du temps médical, trop souvent absorbé par les tâches administratives. D’un côté, Nabla, un assistant vocal qui génère des comptes rendus médicaux, a permis une réduction de deux heures par jour passées sur la documentation. Hopia, quant à elle, a réussi à diminuer de 50% le temps passé à la gestion des plannings au centre hospitalier universitaire de Brest.
Toutefois, lorsque l’IA de planification attribue un créneau prioritaire à un patient stable au détriment d’un cas urgent, la responsabilité médicale en cas de complication repose sur une chaîne décisionnelle floue entre l’outil, le personnel soignant et l’établissement.
Ruptures de fiabilité dans l’IA médicale : des défaillances aux conséquences cliniques majeures
Les risques de fuites de données ou de cyberattaque sont des risques majeurs qui relèvent de la sécurité des plateformes de santé. Mais au-delà de la sécurité technique, un enjeu fondamental réside dans la base de données d'entraînement des IA qui peut sous-représenter la diversité des patients. Les risques engendrés allant de diagnostics erronés à une absence totale de prise en charge peuvent compromettre la durée de vie des patients. L’OMS souligne ce biais dans son guide sur l’éthique et la gouvernance de l’IA pour la santé affirmant que beaucoup d’algorithmes excluent les femmes, minorités, communautés rurales. C’est le cas notamment d’un algorithme, chargé d’attribuer des soins de santé, qui a sous-estimé de 29% les soins qui devaient être attribués aux personnes noires9.
De ce fait, l’IA en santé est soumise à un encadrement réglementaire rigoureux, combinant le règlement européen sur les dispositifs médicaux, l’Artificial Intelligence Act, la loi de bioéthique et le RGPD. À cela s’ajoutent les exigences de certification comme le marquage CE en Europe et l’agrément de la FDA aux États-Unis, qui garantissent la conformité des dispositifs aux standards de sécurité, d’efficacité et de protection des données. Pourtant, des incertitudes persistent quant à la responsabilité en cas d’erreur médicale liée à une décision algorithmique. En 2019, un cas survenu aux États-Unis illustre cette problématique : un algorithme de diagnostic a mal interprété une radiographie, entraînant un retard de traitement fatal. Le fabricant du logiciel et l’hôpital ont alors été conjointement mis en cause sur le plan juridique, soulignant les zones grises du régime de responsabilité en matière d’IA médicale.
Paradoxalement, si ces nouveaux algorithmes promettent des résultats défiant les biais cognitifs des praticiens, une confiance aveugle en ces technologies peut avoir de lourdes conséquences juridiques.
L’avenir de l’IA en santé : anticiper les risques, garantir l’efficacité
L’intelligence artificielle s’impose comme un levier incontournable dans la transformation des pratiques médicales. De la libération du temps médical à un accompagnement vers des traitements ciblés, elle se présente comme un outil robuste dans la diminution des frais médicaux qui se doit d’être intégré à notre système de santé. Pourtant, dans un domaine où chaque décision peut impacter la vie, l’enjeu ne réside pas seulement dans la performance technologique ; des données biaisées, un diagnostic erroné ou encore une cyberattaque peuvent compromettre la prise en charge et mettre en péril des milliers de patients. L’omniprésence de ces risques expliquent en partie son application lente et difficile dans un paysage hautement règlementé. Dans le cadre de l’accélération de son déploiement, il est clair que les développeurs de nouvelles solutions doivent faire preuve d’une transparence sans failles pour anticiper les risques de responsabilités, mais aussi garantir la confiance de ces utilisateurs. Les praticiens, quant à eux, doivent témoigner d’une proactivité encore plus rigoureuse face à l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle, incluant notamment la nécessité de réaliser des formations au numérique. De plus, collaboration et écoute entre les différentes instances et acteurs sont les clés pour fournir des produits faciles et adaptés aux besoins des praticiens dans des centres de santé propices. Le cadre règlementaire, doit être renforcé, encourageant à la fois le développement de ces technologies tout en protégeant ses utilisateurs10.
Notes
- Lancée en janvier 2021 et pilotée par le Secrétariat général pour l’investissement, la stratégie de santé numérique vise à faire de la France un leader mondial dans le domaine, en soutenant l’innovation et la transformation du système de soins.
- Nabla, d’origine française, créée en 2018, conçoit une IA ambiante (Nabla Copilot) pour assister les cliniciens dans leurs tâches quotidiennes et améliorer la qualité des soins.
- Therapixel, d’origine française, créée en 2013, développe des solutions d’IA pour l’analyse d’images médicales, notamment en radiologie.
- Clinical Histopathology Imaging Evaluation Foundation
- L’histopathologie désigne l’étude au microscope de tissus prélevés sur un organe (vivant ou mort), dans le but de diagnostiquer une maladie – par exemple un cancer – en identifiant précisément les anomalies des cellules et l’organisation du tissu.
- Owkin, d’origine française, créée en 2016, utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage fédéré pour accélérer la découverte de médicaments et améliorer les diagnostics en oncologie.
- Synapse Medicine, fondée en France en 2017, développe des solutions d’intelligence artificielle pour sécuriser la prescription médicale et automatiser les tâches administratives grâce à sa suite d’outils « Copilote ».
- Hopia, d’origine française, créée en 2020, développe une solution d’optimisation des plannings hospitaliers grâce à l’intelligence artificielle, pour améliorer la qualité de vie au travail des soignants.
- Jemielity, S. (2019, October 28). Health care prediction algorithm biased against black patients; study finds. University of Chicago News.
- Sadad Lachheb, K. (2025, janvier 10). L’intelligence artificielle en médecine : quelle responsabilité en cas d’erreur ? Village de la Justice

L’intelligence artificielle s’impose comme un levier incontournable dans la transformation des pratiques médicales. De la libération du temps médical à un accompagnement vers des traitements ciblés, elle se présente comme un outil robuste dans la diminution des frais médicaux qui se doit d’être intégré à notre système de santé. Pourtant, dans un domaine où chaque décision peut impacter la vie, l’enjeu ne réside pas seulement dans la performance technologique.
Julien GAMON, Ingénieur-Conseil
